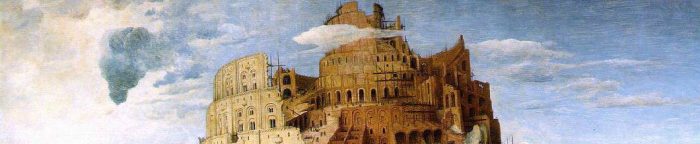Analyse critique
Pierre, un ancien pilote de guerre, est devenu amnésique à la suite d’un accident d’avion en Extrême-Orient. Madeleine, l’infirmière qui l’a recueilli, lui consacre toute sa vie et son amour de femme seule. Un jour, en la raccompagnant à la gare de Ville-d’Avray, Pierre rencontre Françoise, une orpheline de dix ans, qui vit chez les sœurs. Il se prend d’amitié pour la fillette. Puis se faisant passer pour son père, il lui rend visite tous les dimanches. Une tendre et pure complicité s’établit entre eux. Chaque dimanche, ces deux êtres esseulés se retrouvent autour des étangs de Ville-d’Avray et plongent avec une délectation morose dans un monde imaginaire. Des deux, c’est Cybèle qui semble la plus mature, Pierre ressemblant à un enfant perdu. Mais cette relation fait bientôt scandale dans la ville.
Il faut remarquer la peinture de paysage hivernal, digne d’une estampe japonaise, et les deux acteurs, singuliers : Hardy Krüger, surtout connu pour son rôle dans Un taxi pour Tobrouk, et Patricia Gozzi, étonnante par son aplomb d’enfant-femme. La mise en scène de Serge Bourguignon, qui signait là son meilleur film au milieu d’une carrière plutôt terne, est un peu lente ; de douce, l’idylle devient parfois doucereuse. Mais le film intrigue par son audace tranquille. En effet, le lien, pur et romanesque entre l’adulte et la jeune fille pourrait, de nos jours être interprété comme une complaisance envers la pédophilie.
Bénéficiant d’un scénario qui fait la part belle à l’évocation plutôt qu’à la démonstration, d’une splendide photographie en noir et blanc d’Henri Decae, d’une musique relativement discrète de Maurice Jarre, de l’utilisation de vieilles chansons françaises (« Aux marches du palais »), du format Cinémascope et de la présence d’acteurs tout en retenue, Les Dimanches de Ville d’Avray évite les pièges du sensationnalisme et du moralisme.
Mais c’est bien de pédophilie dont le film parle, sans, évidemment, jamais en prononcer le mot ni montrer ou même laisser penser à un passage à l’acte. Les deux personnages principaux, Pierre et Cybèle, sont chacun à leur façon, deux exclus qui se trouvent sans s’être cherchés. Pierre, psychologiquement et émotionnellement instable, depuis son accident oriental, a régressé au stade de l’adolescence, des pulsions difficilement contrôlables et de l’inconfort social. Cybèle, petite fille précoce qui est toujours plongée dans les livres et a ses opinions définitives sur tous les sujets, a été sevrée d’amour parental trop tôt, sa mère est morte, son père l’a abandonnée lâchement et a compensé son statut d’orpheline solitaire en ayant développé des capacités intellectuelles et une indépendance peu communes à son âge. Lorsque leurs trajectoires se croisent, Pierre et Cybèle se reconnaissent l’un en l’autre, dans leur détresse affective et leur isolement social.
Autour de Pierre et de Cybèle gravitent quelques personnages secondaires, mais remarquables. D’abord, l’amie de Pierre, Madeleine, qui essaye de comprendre avec toute la tendresse et l’amour qu’elle a pour Pierre son attachement à la petite fille et qui le regarde petit à petit s’éloigner d’elle. Ensuite Carlos, l’ami et le confident de Pierre, un sculpteur qui lui aussi, essaye d’accepter l’étrange relation qui s’est tisée entre son ami et la gamine. Madeleine et Carlos, le moment venu, défendront Pierre contre la rumeur et les attaques, au risque de leur propre réputation. Tout le talent du scénario est de placer le spectateur dans la position de Madeleine et de Carlos et non pas dans celle de Cybèle et de Pierre. La distance nécessaire pour ne pas faire sombrer le film dans le racolage mélodramatique vient de ce point de vue extérieur à celui des deux personnages principaux du film. La naissance et l’évolution de la relation entre l’adulte et de la fillette nous sont présentées sans jugement social ou moral : comme Madeleine et Carlos, nous devons regarder et tenter de comprendre avant d’accepter de reconnaître notre incapacité à le faire.
Les dimanches de Ville d’Avray fait la part belle aux scènes intimistes et silencieuses, comme les promenades au bord des étangs de Ville d’Avray, dans le froid des dimanches d’hiver. Ou comme les scènes entre Pierre et Madeleine chez eux, dans la proximité de leurs corps et l’éloignement de leurs âmes. L’une des plus belles scènes du film est la rencontre de Pierre et de Cybèle avec un groupe d’enfants dans le parc du bord de l’eau. Sans effet démonstratif mais tout en nuance, Bourguignon nous y montre que Cybèle appartient au monde de l’enfance et que Pierre en est sorti depuis longtemps, et que, malgré leur proximité affective, leurs univers sont irrémédiablement disjoints.
Distribution
Fiche technique
Retrouvez tous les détails techniques sur la fiche IMDB |
[Source : ann.ledoux.free.fr]