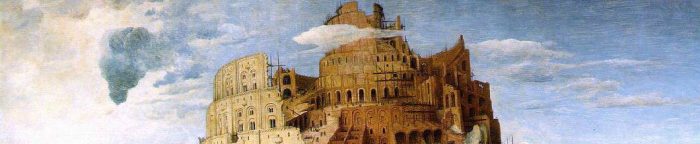La révolution comme mode de vie de Vivian Gornick raconte la vie passionnante d’Emma Goldman, figure clé de l’anarchisme international au tournant du vingtième siècle. Les Lettres à l’amant, textes choisis par Léa Gauthier, révèlent les sources érotiques de son engagement.
Écrit par Steven Sampson
L’anarchisme n’est plus à la mode, les attentats d’aujourd’hui se font au nom d’autres idéologies. Lorsqu’on considère les anarchistes de l’après-guerre, on voit que le mouvement devient autant esthétique que politique, la gauche partageant la scène avec la droite, celle-ci représentée par des gens comme Antoine Blondin, Denis Tillinac ou Michel Audiard.
Ce n’était pas le cas à l’époque d’Emma Goldman (1869-1940). Juive russe née dans la ville impériale de Kovno, elle anticipait pourtant l’évolution actuelle : selon sa biographe Vivian Gornick, elle faisait partie d’une poignée de radicaux qui, au fil des siècles, ont eu l’intuition que la révolution devait « inclure une saine passion pour la vie intime ». Pour elle, la lutte contre l’autorité gouvernementale coercitive était liée au droit de vivre de manière sensorielle. Goldman, d’après Gornick, essayiste et autrice d’Attachement féroce, haïssait l’État centralisé du fait de son mépris pour les sentiments des individus : « Sentir est le mot-clef. » Pour reprendre les paroles d’Emma, rhétoricienne remarquable, il fallait « sentir dans chacune de ses fibres comme une flamme, une fièvre dévorante, une passion élémentaire ». Goldman attendait autant de ses camarades, et en fut souvent déçue, thème récurrent de ce livre.
Comme nous l’apprend Freud – influence majeure sur Goldman ainsi que sur Gornick –, tout se joue dans l’enfance. Les Goldman étaient des commerçants juifs au caractère bien trempé, leur vie était empreinte « d’une soif de satisfaction émotionnelle qui demeura hors d’atteinte ». Battue par son père tout au long de son enfance, Emma était dotée d’un esprit indomptable. Sa scolarité prit fin à douze ans, lorsque le professeur de religion déclara qu’elle était « une enfant terrible qui deviendrait une femme pire encore ». Elle rêvait d’attention sexuelle, d’histoires d’amour et de voyages, et sentait instinctivement que l’injustice sociale, en déclenchant chez elle des émotions profondes, en appelait à « son moi le plus sensible ».
Le radicalisme politique fut sa première grande histoire d’amour : tout comme Lénine, elle a été bouleversée par Que faire ? (1863), roman de Nicolaï Tchernychevski, où la protagoniste féminine quitte sa famille, intègre une cellule radicale, et meurt pour la révolution. Quand, avant son seizième anniversaire, son père lui annonça qu’il allait lui chercher un époux, parce que « tout ce qu’une juive doit savoir, c’est cuisiner la carpe farcie, cuire correctement le Kugel de nouilles et faire des bébés à son mari », elle supplia qu’on la laisse partir en Amérique, vœu réalisé après un chantage au suicide. Après le passage obligatoire par Ellis Island, elle s’installa à Rochester, dans l’état de New York, où elle travaillait dans des usines de textile. Son expérience l’a sensibilisée aux arguments de Marx, qui voyait l’industrialisation comme un système esclavagiste basé sur l’humiliation, dont la finalité est une déformation de l’âme.
Le rassemblement en soutien aux grévistes sur le Haymarket Square de Chicago en 1886 marqua un tournant dans sa pensée. Elle s’enflamma à la prose du militant Johann Most dans la publication new-yorkaise Die Freiheit, et déclara que c’était son analyse des procès de Haymarket Square – huit dirigeants syndicaux de Chicago, tous anarchistes, furent inculpés pour un attentat à la bombe – qui avait « cristallisé sa vision politique ».
En 1889, âgée de vingt ans, elle débarqua à New York avec une machine à coudre et cinq dollars en poche. Le jour de son arrivée, elle découvrit le café Sachs, le QG des anarchistes de la ville, et fit la connaissance d’Alexandre « Sasha » Berkman, lui aussi juif originaire de Kovno, destiné à devenir la personne la plus importante de sa vie. Le soir même, elle écouta un discours de Johann Most, dont elle apprendrait l’art oratoire. Most évoquait ouvertement l’idée de l’assassinat politique. En 1892, elle et Berkman décidèrent d’assassiner Henry Clay Frick, magnat de l’acier. Sasha parvint à poignarder Frick à la jambe, écopant de vingt-deux ans de prison. Le comité de soutien formé par Emma l’a amenée à faire la rencontre d’Ed Brady, grand Autrichien blond, de dix-sept ans son aîné. Dans la prose de Vivian Gornick, il fut « le premier homme à ne pas se contenter de la pénétrer, mais à lui faire l’amour : une évolution importante à plus d’un titre pour elle, qui avait ce que l’on appelait à l’époque un ‘utérus rétroversé’ ». Emma dirait de lui : « Dans les bras d’Ed, je compris pour la première fois la signification de cette force vitale extraordinaire. Je saisis toute sa beauté et je bus fougueusement sa joie, sa volupté enivrante. »

Emma Goldman dessinée par Marguerite Martyn, dessin publié dans le St. Louis Post-Dispatch (1908) © CC0/WikiCommons
Emma Goldman fut une grande romantique, comme le montre Vivian Gornick, sa vie fut ponctuée par une série de rencontres tumultueuses laissant l’intéressée sur sa faim. C’est en cela que l’approche de Gornick fait sens : on ne peut dissocier la vie intime de Goldman de son engagement militant. Selon la biographe, l’anarchisme serait « une expérience protéiforme », une « attitude », ou un « état d’esprit » prenant deux formes : celle de la vie en collectivité – où l’on insiste sur la lutte des classes – et celle de l’individuel, focalisé sur la libération intérieure de l’individu. Pour Gornick, Goldman est une anarchiste « hybride » : d’un côté, elle a consacré sa vie à dénoncer l’État ; de l’autre, sa première passion fut les travaux des philosophes allemands de l’individualisme (Nietzsche et Stirner) et des transcendantalistes américains (Thoreau et Whitman).
Lettres à l’amant met en lumière le versant individualiste d’Emma Goldman. Dans une quinzaine de textes judicieusement choisis par Léa Gauthier – six lettres à son amant Ben Reitman, ainsi que des articles tirés des recueils et des journaux, dont celui qu’elle a fondé, Mother Earth –, elle évoque entre autres l’hypocrisie du puritanisme, les aspects sociaux du contrôle des naissances, l’anarchie dans son rapport à la sexualité et la « versatilité des suffragettes ». Dans une lettre du 27 septembre 1908 adressée à « Mon très cher vagabond », Ben Reitman, homme de dix ans son cadet, elle écrit : « Aucun homme ne m’a aimée comme tu l’as fait. Je connais l’extase, la jouissance inexprimable que ton amour peut donner, mais je sais aussi que pendant que mon corps et mon âme se régaleront du nectar de la vie, mon esprit attendra, affamé par le manque de compréhension et ne recevra rien… Tu as ouvert les grilles de la prison dans laquelle était enfermée ma féminité. Et toute la passion qui était enchaînée, insatisfaite en moi pendant tant d’années, a bondi tempétueuse, sauvage, imprudente, illimitée comme la mer… Que puis-je faire sinon suivre l’appel de la nature sauvage, celui du maître en amour ?… S’il me fallait choisir entre un monde de compréhension et la source qui remplit mon corps de feu, je choisirais cette dernière…Je te donnerai mon âme, mais laisse-moi te boire, toi mon maître en amour. »
On dirait les sœurs Brontë, ou, dans un registre plus contemporain, Diana Ross. Ce que le mouvement anarchiste a gagné en Emma Goldman fut une perte pour le monde des lettres. Aujourd’hui, heureusement, cette lacune est comblée grâce aux livres de Vivian Gornick et de Léa Gauthier.
[Source : http://www.en-attendant-nadeau.fr]