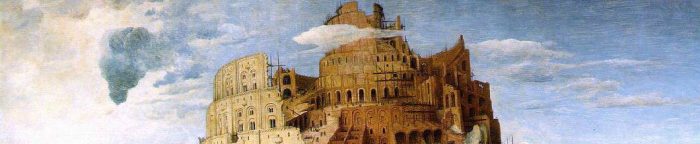« Kill da wabbit, kill da wabbit… » Pour une certaine génération de drogués de la culture pop, la première image qui vient à l’esprit lorsque Richard Wagner arrive est Elmer Fudd, vêtu d’une armure brillante et d’un casque à cornes, mutilant « The Ride Of The Walkyries » alors qu’il chasse (et convoite !) opérativement après sa proie de lapin. Peut-être qu’à la place, on imagine une volée d’hélicoptères militaires américains planant au-dessus de la côte vietnamienne dans Apocalypse Now, faisant pleuvoir des bombes et des balles alors que la chanson la plus célèbre du compositeur du XIXe siècle noie à la fois des lames tourbillonnantes et des corps hurlants. Ou peut-être que l’on pense à l’Allemagne nazie, où l’œuvre de Wagner était « le Muzak du génocide », comme l’appelle l’auteur Alex Ross dans son dernier livre, Wagnerism : Art And Politics In The Shadow Of Music, un examen dense et éclairant de l’influence de Wagner sur la culture et l’histoire.
Wagner était l’artiste événementiel monoculturel de son époque : un compositeur dont les opéras ambitieux (dont Lohengrin, Parsifal, Tristan und Isolde et le cycle Ring en quatre parties ) ont introduit des techniques et des concepts qui ont influencé la culture à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Dans son livre de 2007, The Rest Is Noise: Listening To The Twentieth Century, Ross, critique musical pour The New Yorker, a brièvement évoqué l’influence de Wagner sur le monde de la musique, détaillant une lignée de musique classique moderne d’avant-garde qui commence avec Wagner acolytes Richard Strauss et Gustav Mahler. Avec le wagnérisme, Ross retrace l’influence du compositeur controversé à travers ce que l’auteur appelle les « artistes du silence » : les romanciers, les poètes et les peintres.
Ce qui fait du wagnérisme une lecture si stimulante et gratifiante, c’est la façon dont Ross accepte cette influence. Admettant ses premières impressions négatives sur Wagner comme « l’ombre de Nosferatu tombant sur cette époque », Ross brosse un tableau de Wagner qui complique son image de compositeur préféré du fascisme. Quand Walt Whitman a écrit : « Est-ce que je me contredis ? Très bien, alors je me contredis », pouvait-il aussi bien parler des nombreuses volte-face philosophiques de Wagner.
Wagner s’est associé à des anarchistes comme Mikhaïl Bakounine et a prononcé avec passion des discours sur la « révolution perpétuelle », a plaidé pour la dissolution de l’aristocratie et a incorporé des influences spirituelles du kabbalisme, de l’islam et de l’hindouisme dans ses récits d’opéra sur les quêtes du Graal et les dieux nordiques. Wagner était également un antisémite et un raciste qui a salué la guerre civile comme « la seule guerre dont le but était humain » pour mettre fin à l’esclavage et a applaudi le roi du Zoulou pour avoir vaincu les Britanniques dans les premières parties de la guerre anglo-zouloue. L’homme dont le travail allait inspirer le Troisième Reich a écrit un jour « le désir de conquérir d’autres terres est « non allemand » » et a vécu un style de vie androgyne, parfois campy, qui l’aurait condamné en tant qu’artiste décadent et dépravé par ce régime. À cause de ce que Ross appelle « le flou emphatique de ses convictions »,« des groupes entiers qui auraient de bonnes raisons de licencier Wagner pourraient toujours le revendiquer comme l’un des leurs. »
Ross explore ces facettes contradictoires de la vie et de l’œuvre de Wagner en regardant comment il est perçu par ses admirateurs. Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique qui a jeté les bases de l’établissement de l’État d’Israël, a tiré tellement d’inspiration et d’énergie du travail de Wagner qu’il a dit « ce n’est que les soirs où il n’y avait pas d’opéra que j’avais des doutes sur la justesse de mon idées. » Dans l’une de ses nouvelles, WEB Du Bois a imaginé un homme afro-américain se remémorant avec tendresse une représentation de Lohengrin comme son dernier souvenir heureux alors qu’il était sur le point d’être pendu par une foule de lyncheurs. Les féministes et les artistes gays se sont retrouvés dans les Walkyries de Wagner et dans les courants homoérotiques qui parcourent ses opéras.
L’anarchiste Emma Goldman s’est concentrée sur l’attrait interculturel de la musique de Wagner, écrivant que son travail est « la force libératrice des émotions refoulées, étouffées et cachées de leurs âmes ». À une époque où tant de groupes différents devaient vivre sous diverses formes d’oppression, le pouvoir transcendant de la musique de Wagner leur donnait un moyen de ressentir et d’exprimer des émotions qu’ils étaient souvent contraints, pour survivre, de réprimer.
Au cours de plus de 700 pages, Ross couvre une quantité énorme de terrain, abordant la révolution russe, la naissance du cinéma, les deux guerres mondiales, et un who’s-who de poids lourds artistiques et philosophiques, dont James Joyce, Willa Cather, Luis Buñuel, Yukio Mishima, George Eliot, Marcel Proust, Virginia Woolf, Mark Twain et Friedrich Nietzsche. Le wagnérisme est heureusement léger sur la terminologie de la théorie musicale qui a fait de The Rest Is Noise une lecture parfois frustrante pour ceux d’entre nous qui ne pouvaient pas identifier un triton à l’oreille si vous nous mettez un pistolet sur la tête. Et tandis que Ross offre beaucoup d’informations biographiques et d’anecdotes sur Wagner, il se garde bien de le psychanalyser ou de trouver des excuses pour les défauts majeurs de son sujet.
Le wagnérisme ne préconise pas de séparer l’art de l’artiste. Avec un artiste dont l’héritage est aussi confus et compliqué que celui de Wagner, ce genre de chirurgie est impossible. Quel Wagner supprimez-vous ? Ross insiste sur ce point tout au long du livre : Il n’y a pas de Wagner définitif, c’est un prisme à travers lequel tant d’artistes et de penseurs différents ont réfracté leur propre lumière. « L’essence de la réalité réside dans sa multiplicité infinie », a écrit Wagner. « Seul ce qui change est réel. »
Là où était un homme, il n’y a plus qu’une ombre. La forme que prend cette ombre, suggère le wagnérisme , en dit autant sur le spectateur que sur le corps qui l’a autrefois projetée.
[Source : http://www.upost.info]